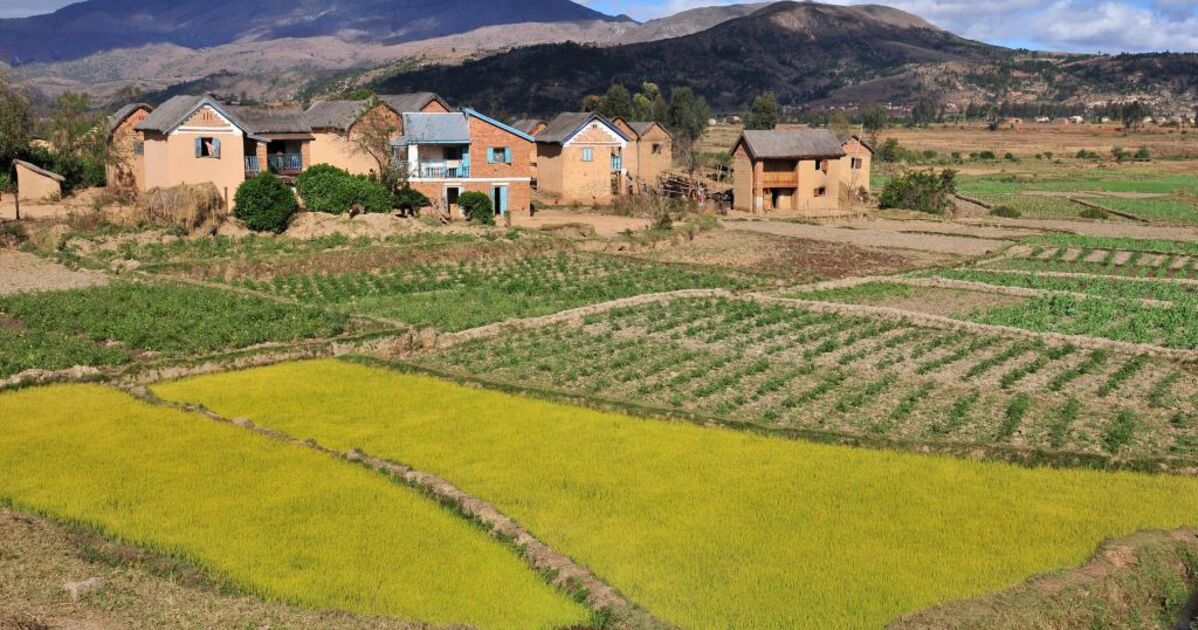Pour réussir, la ZLECAf doit concerner le libre-échange réel, et non le “libre-échange” géré par le gouvernement
La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est la plus grande zone de libre-échange au monde en nombre de pays. C’est le projet de libre-échange le plus ambitieux et, compte tenu des tendances démographiques, le plus prometteur au monde. La ZLECAf est très importante pour les économies africaines séparément et pour le développement économique collaboratif et intégré […]