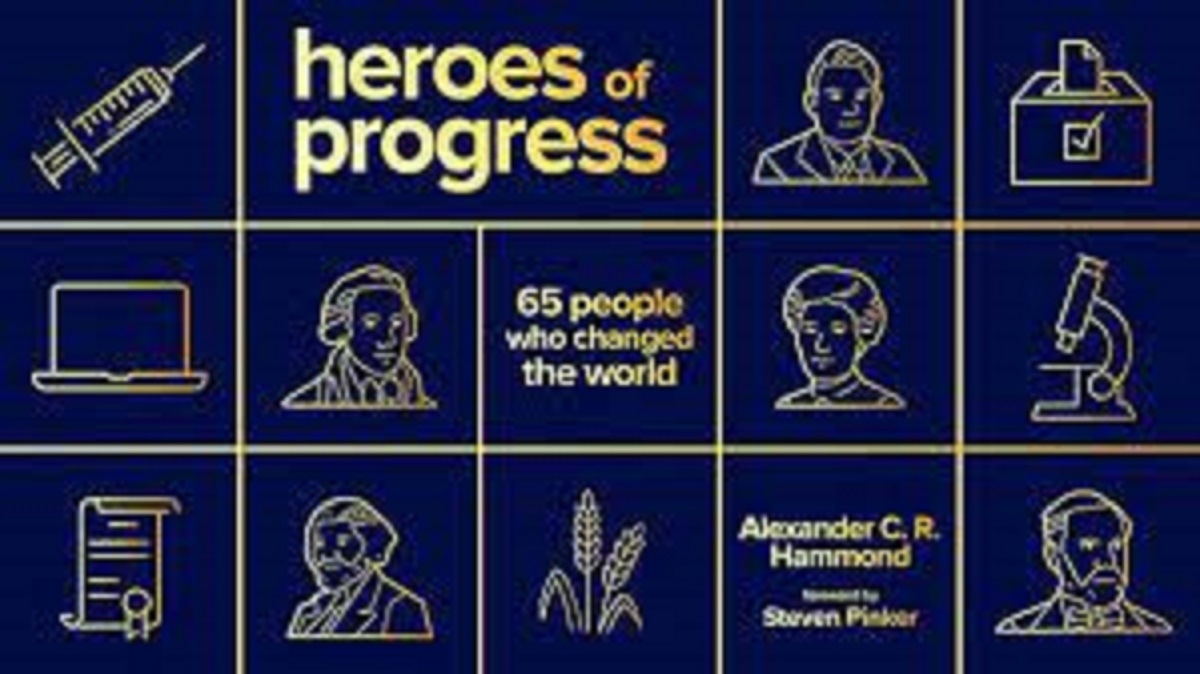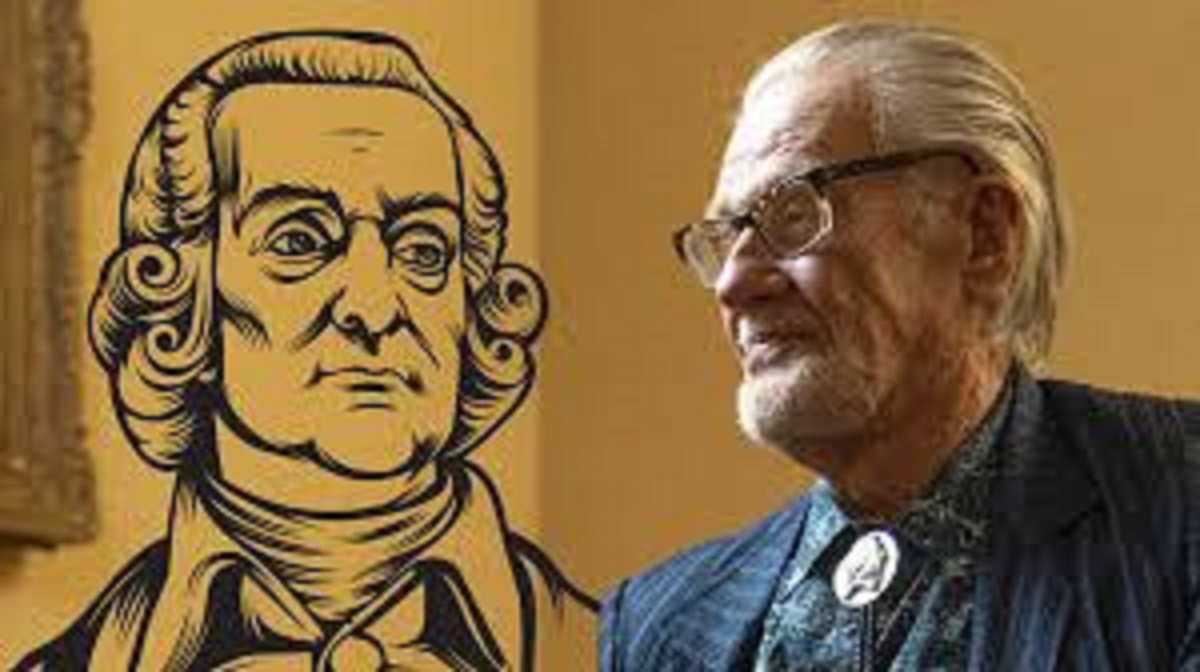Le commerce intra-africain s’améliore : signe encourageant pour le continent
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a publié sa dernière mise à jour sur le commerce mondial et, en bref, il y a de bonnes nouvelles. Tout d’abord, les flux commerciaux internationaux se sont contractés pendant plusieurs trimestres, mais il semble que les choses vont rebondir en 2024. Deuxièmement, certaines régions […]